Parcelles à risque : ce qui fonctionne
On peut agir, sans forcément aller jusqu’au semis direct sous couverts vivants, même si certains y vont ! », souligne Hélène Pouget, d’Agri-Viaur, un programme d’actions coordonné par le syndicat mixte du Bassin Versant du Viaur, en Aveyron. « C’est encore mieux si on raisonne à l’échelle d’un bassin-versant. À l’échelle de la parcelle, il existe de petites interventions localisées qui ont fait leurs preuves, comme l’implantation de petites haies dans les zones d’écoulements préférentielles. L’idée est de réduire la vitesse de l’eau et de faciliter son infiltration, par tous les moyens. Oui, réduire la profondeur du travail, et labourer dans le sens perpendiculaire de la pente, c’est mieux. Il y a déjà des améliorations dans les exploitations, mais on est conscients que sur des événements aussi extrêmes que ceux du printemps 2023, c’est compliqué. »

Haie double sur talus, implantée dans une parcelle en Aveyron pour limiter l’érosion (©Agri Viaur)
S’il ne peut que constater les dégâts lors de fortes pluies, l’agriculteur dispose de quelques outils pour tenter de ralentir l’eau et la terre qui s’érodent pendant les intempéries. Le point avec Candice Chabot, Conseillère en agronomie, érosion et ruissellement au sein de la Chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais.
Pas de magie
« Il n’y a pas de recettes magiques. C’est une évidence pour toutes les personnes ayant déjà vu de fortes pluies s’abattre sur les parcelles agricoles. Néanmoins, si on ne peut pas bloquer l’eau lorsqu’elle est abondante, on peut tenter de bloquer la terre (souvent la partie la plus riche des sols) qu’elle emporte avec elle pour éviter qu’elle n’arrive en aval. »
Couvrir ses sols
La couverture permanente permet aux plantes, implantées durablement de capter l’eau mais aussi de retenir la terre. Dans une moindre mesure, les couverts d’intercultures peuvent empêcher l’eau de se répandre sur toute la pente. Cependant, « c’est une technique plutôt efficace mais l’implantation des couverts est conditionnée par le climat, fait remarquer Candice Chabot, conseillère spécialisée en érosion à la chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais. Pour qu’il soit utile, il doit être suffisamment développé. »
Des fourrières différenciées
« L’idée est d’implanter une bande enherbée ou du miscanthus entre la parcelle et les fourrières, explique la conseillère. Ou encore des cultures annuelles ou pérennes. Ce type de parcelles peuvent être disposées de manière stratégique sur le bassin-versant. » Dans la même veine, le découpage des parcelles peut être réfléchi en alternant les cultures d’hiver et de printemps afin de limiter l’érosion. « C’est plus facile à mettre en place mais cela peut représenter une contrainte pour certains parcellaires agricoles. »
Moins travailler son sol
Même si cela peut paraître une évidence, le travail du sol entraîne une mobilité plus importante des sédiments. Mais selon le travail réalisé, les agrégats peuvent également retenir de l’eau. « Le travail du sol et les conséquences dépendent vraiment du type de sol » , ajoute-t-elle. C’est à l’agriculteur de le connaître pour adapter ses pratiques s’il le souhaite. Il est aussi important de rappeler de travailler perpendiculairement à la pente si la forme de la parcelle le permet. Cela demande de s’adapter à la topographie des parcelles qui n’est pas toujours homogène.
De la matière organique
Un sol plus riche, grâce qui aura une meilleure structure, infiltrera mieux l’eau et sera donc moins sensible au ruissellement. « Mais augmenter le taux de matière organique demande du temps, la solution se trouve donc à long terme », ajoute-t-elle.
Pour lutter contre les précipitations de printemps, certains producteurs de pommes de terre optent pour les barre-buttes. Réalisées par des planteuses spécifiques, les petites buttes placées à la perpendiculaire entre les grandes buttes permettent de stopper l’eau qui pourrait dévaler entre les buttes. « Une technique qui demande un matériel spécifique et qui reste limité, ajoute la conseillère. Mais c’est relativement efficace dans les parcelles de pommes de terre au printemps. »
Rien n’est facile…
Parmi toutes ses possibilités, Candice Chabot tient à rappeler que « rien n’est facile. Si les agriculteurs sont bien conscients de l’enjeu et du risque, les techniques agronomiques restent parfois complexes à mettre en place. La météo, la gestion des ravageurs ou des adventices sont des aspects parfois peu maîtrisables. Il y a également un enjeu financier. » Cependant, le sol reste le capital de l’agriculteur qu’il convient de prendre soin. Si ces pratiques demandent du temps à mettre en place, elles ont le mérite de retenir les sédiments ou tout du moins d’atténuer les conséquences.
Elles peuvent aussi être complétées au cas par cas par des ouvrages d’hydraulique douce (voir ci-dessous).
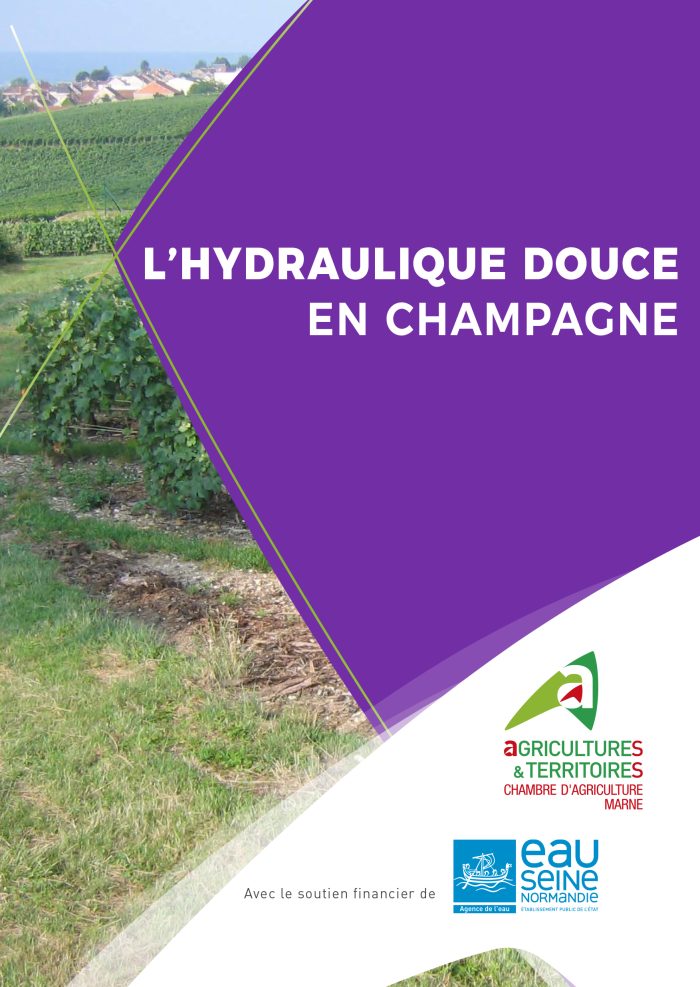
La cellule ‘Érosion’ de la Chambre d’agriculture de la Marne a produit un formidable petit Guide de l’hydraulique douce en Champagne. Adaptable à toutes les zones, il est gratuit et disponible sur internet. L’hydraulique douce, ou ‘génie végétal’, permet de construire des solutions techniques à base de plantes vivantes ou mortes pour régler des problèmes de sols, notamment d’érosion.
De son côté, Franck Chevallier, de Paysages Fertiles (consuktant spécialisé dans le Keyline Design, méthode de gestion des eaux de ruissellement pratiquée dans les pays anglo-saxons), complète en listant des techniques issues de sa pratique : « Les parcelles peuvent être redécoupées par des fossés ‘à plat’. Le rôle de ces canaux en courbe de niveau est d’intercepter ce ruissellement, de le stocker le temps qu’il s’infiltre dans le sol. En sol très argileux, ces ouvrages sont peu pertinents. Dans ce cas, si la parcelle comprend une crête plus caillouteuse, on incline légèrement le canal pour diriger l’eau vers la crête et l’infiltrer dans cette zone. Une autre possibilité est de diriger l’eau vers une zone propice à la création d’une réserve collinaire. D’où elle pourra être réutilisée pour l’abreuvement ou pour l’arrosage lors de sécheresses. Des arbres peuvent être associés aux canaux pour en multiplier les effets : meilleure infiltration et rétention d’eau dans le sous-sol. Canal et alignement d’arbres peuvent être répétés tous les 10 m, 25 m… selon l’approche culturale de la ferme. C’est de l’agroforesterie avec un effet plus marqué sur l’hydrologie. »
Exploitation : TCS, SD… investir ou pas ?
Moins travailler le sol, ou moins profondément, pour réduire le risque érosif : cela semble évident. Oui, les sols bien couverts souffrent moins des épisodes de précipitations hors-norme. Pour autant, cela signifie-t-il qu’il faut se ruer sur les Techniques culturales simplifiées et les semoirs de semis direct ? « Attention aux effets d’opportunité », met en garde Sébastien Jalby, animateur agroéquipement au sein de la fédération des cuma du Tarn. Dans ce département, de nombreuses cuma ont investi dans des semoirs de semis direct. Si certains groupes ont désormais un ‘parc’ de 4 de ces semoirs, régulièrement utilisés, d’autres ‘dorment’ sous les hangars.

Le semis direct fait son chemin dans les cuma, comme ici à la cuma de Garlin (semoir Sola) dans les Pyrénées Atlantiques.
C’est la stratégie d’exploitation complète qu’il faut revoir
« Les groupes dans lesquels cette activité fonctionne sont ceux qui sont animés par des agriculteurs réellement engagés, qui ont réfléchi leur stratégie d’exploitation en ce sens : leurs assolements sont pensés pour cela, ils adhèrent à des associations spécialisées, regardent les références locales. »
« Ce sont des techniques exigeantes : il faut intervenir un semoir adapté à son sol, et au bon moment. Les utilisateurs ‘opportunistes’ ont vécu des échecs logiques, car on ne sème pas en direct de but en blanc, sans que le sol soit prêt en termes de structure et de biologie : il s’agit bien d’une stratégie d’exploitation complète qu’il faut revoir, des assolements à la commercialisation en passant par le parc matériels. Et tous les semoirs direct ne sont pas adaptés à tous les types de sols. » Même prudence concernant les techniques culturales simplifiées : « Dans certains secteurs du Gers, analyse Florent Georges de la fdcuma du Gers, ces techniques ont abouti à une intensification du travail superficiel. Ce qui a eu pour effet, sur certains sols, de faciliter le glissement de cet horizon très travaillé lors de fortes précipitations. » Des mises en garde importantes : un semoir de semis direct à lui tout seul ne pourra pas contrer les phénomènes érosifs.
En groupe, penser « territoire » et bassin versant
Mais pour lutter contre ce risque d’érosion, l’agriculteur peut s’appuyer sur ses voisins. Ensemble, des pratiques agronomiques peuvent être prises. À l’image d’un assolement concerté au sein d’un bassin-versant. L’idée est d’alterner les cultures d’hiver, d’été, pérennes et annuelles pour tenter de retenir l’eau.Outre les agriculteurs, les collectivités se sont emparées du sujet. Sur certains territoires, élus, agriculteurs, conseillers et experts se concertent pour réaliser des ouvrages afin de limiter l’érosion et ses conséquences. Quelques exemples.

Dans le Sud de l’Espagne, les Maures ont construit entre le VIIIe et le Xe siècle plus de 15 000 km d’acequias, de touts petits canaux, pour la plupart creusés directement à flanc de colline, permettant de ralentir et distribuer dans l’ensemble du bassin versant l’eau des rivières, de la pluie, de la fonte des neige. Aujourd’hui, sous l’impulsion des archéologues du MEMOLab, de l’Université de Grenade, des associations d’irrigants et des bénévoles dégagent et entretiennent ces structures, pour la plupart tombées en désuétude dans les années 1960. (© Page Facebook du MEMOLab)
Fascines
« Quelles soient mortes ou vivantes, leur effet est direct et indiscutable, indique Candice Chabot, de la Chambre d’agriculture du Nord Pas de Calais. Il faut qu’elles soient positionnées aux endroits des ravines ou des passages d’eau fréquents sur tout le bassin-versant. » Mais elles demandent également de l’entretien. Sans fagots installés régulièrement, tailles et vérification des pieux, elles peuvent être efficaces. C’est grâce à l’ouvrage entier qu’elles pourront filtrer l’eau et retenir les sédiments. Point négatif : il faut compter entre 50 et 110 €/m linéaire.

La fascine tressée ou clayonnage peut être implantée sur les zones de passage préférentiel de l’eau. Elle est peu consommatrice en foncier et retient 40 à 95% des sédiments. (©JF.Ouvry – AREAS)
Haies
Celles-ci mettent plus de temps à être réellement efficaces. « Il faut compter six ans pour qu’elle soit suffisamment touffue pour retenir l’eau et la terre », estime la conseillère.

La haie dense retient également 40 à 95% des sédiments. (©JF.Ouvry – AREAS)
Bandes enherbées
Positionnées aux endroits stratégiques, elles peuvent avoir un effet sur le ruissellement de l’eau. C’est un peu le même fonctionnement que les fourrières différenciées.
Bassins de rétention
En amont ou en aval, ils permettent de récolter l’eau ruisselée ainsi que la terre emportée. Ils peuvent être couplés avec des haies pour éviter de colmater les bassins avec des sédiments.
Fossés à redents
Eux sont créés pour ralentir l’eau et retenir la terre par sédimentation. Arborés et avec différents niveaux de paliers, l’eau peut sédimenter et ainsi éviter l’encombrement en terre des rivières, routes, habitations et fossés en aval.
Ces ouvrages, inspirés des techniques d’hydraulique douce sont souvent mis en place à la suite d’études réalisées sur le territoire. Et sont financés par les collectivités territoriales ou l’Agence de l’eau. Leur efficacité est décuplée lorsque les ouvrages sont réalisés sur la totalité du bassin-versant de manière cohérente en complémentarité des pratiques agronomiques. Mais Candice Chabot le rappelle, « l’objectif est d’infiltrer l’eau dans la parcelle et de limiter la perte des sédiments lors de très fortes pluies. » En cas de grosse fréquence, il sera difficile de retenir l’eau, mais la terre c’est possible.
De l’eau mieux répartie dans les sols
Pour lutter plus efficacement, Jean-François Ouvry, directeur de l’association Aréas (l’Association de recherche sur le Ruissellement, l’Érosion et l’Aménagement du Sol, basée en Haute-Normandie), préconise de recréer ou maintenir, selon les zones, 1 % des surfaces du territoire en zones tampon. « Cela passe par des aménagements intra parcellaires ou au niveau du territoire, estime-t-il. L’implantation de haies, de bandes enherbées, de talus, etc. L’objectif est de réduire le ruissellement et l’érosion. »
La bonne nouvelle, c’est que cet objectif n’est pas inatteignable. Ces mesures se développent et sont aussi soutenues par les associations, syndicats de bassin-versant ou chambres d’agriculture. Elles peuvent être financées par les collectivités ou les agences de l’eau notamment. « Le but est de limiter le ruissellement et l’érosion par la réduction des impacts de gouttes de pluie sur le sol », répète-t-il.
Par ailleurs, à l’échelle du territoire, on peut remarquer que le risque érosif est davantage pris en compte. Alors qu’avant, l’urbanisation ne se souciait peu de la gestion des eaux pluviales, celles-ci sont beaucoup mieux prises en charge. « Dorénavant, ces eaux sont réintégrées dans des bassins ou sous la voirie », illustre Jean-François Ouvry.
Au niveau ‘paysage’, Franck Chevallier, de Paysages Fertiles, choisit de décrire « ce que serait le contraire d’un paysage agricole pauvrement aménagé : des cours d’eau pourvus de leur ripisylve et des sommets de colline arborés (selon les situations, de 30 à 100 arbres par hectares). Des zones trop pentues maintenues végétalisées. C’est le minimum d’une matrice paysagère dont le sous-sol ne se purge pas après chaque pluie. Les arbres favorisent l’infiltration et maintiennent l’eau dans le sol, faisant que les sources coulent plus régulièrement. Alors qu’un fossé draine, un cours d’eau arboré qui serpente a un effet buvard. Ses rives sont doucement hydratées sur plusieurs mètres. De plus sommets arborés et ripisylves participent à réguler l’humidité ambiante. »
Il conclut : « Remettre de la rugosité dans les paysages, c’est du taf, de l’investissement, des parcelles plus petites, pas droites. En gros c’est se compliquer la vie. Mais ne pas récolter ne serait-ce que deux années sur cinq, c’est se priver dangereusement de ressources. Et voir la terre partir, la MO baisser, des arbres disparaître et les paysages se simplifier… c’est tendre irrémédiablement vers la désertification. Les plus visionnaires d’entre nous verront dans les arbres une ressource fourragère ou énergétique, et une aide précieuse pour construire les sols. Ils verront aussi que ça demande une gestion plus fine, mais qu’ils peuvent diversifier leurs productions, baisser leur dépendance aux intrants et sécuriser leur revenu. Dans l’idéal, ça se réfléchit à l’échelle du bassin-versant. Cependant, pour en revenir à l’érosion, des applications à la parcelle auront des effets significatifs. Si nous sommes suffisamment clairvoyants, nous envisagerions un remembrement agricole avec l’intention de créer une matrice paysagère support de la matrice agricole. »
Pour Jean-François Ouvry, de l’Aréas, la lutte contre l’érosion n’implique pas forcément une réduction des rendements. « En consacrant 1 % du territoire à l’infiltration de l’eau dans le sol, on ne prend pas beaucoup de risques, met-il en perspective. Et surtout, le rendement, d’un point de vue économique peut aussi être voisin, économique. En faisant évoluer quelque peu ses pratiques, les charges peuvent être réduites. » Heureusement, car notre pays a toujours besoin de produire son alimentation.
[Témoignages]
« Agir sur l’eau qui s’écoule»

Jean-Paul Dallene, agriculteur à Oppy dans le Pas-de-Calais
Jean-Paul Dallene est agriculteur à Oppy dans le Pas-de-Calais : « Je ne suis pas dans une zone à forte érosion, mais j’ai quelques parcelles qui se situent dans une zone vallonnée. Je sème des couverts sur mes sols depuis longtemps. D’abord pour répondre à la réglementation mais depuis quatre ans, j’intensifie ma démarche en semant des mélanges de huit espèces. La levée de ce couvert est parfois très difficile comme l’été dernier où j’ai dû attendre les pluies pour les semer. Cette année j’espère les implanter juste après la moisson. En fin de saison, j’essaye de les détruire au dernier moment, sans labourer mes parcelles pour que l’effet soit le plus possible bénéfique.
Si l’objectif de ma démarche était plutôt de gagner en matière organique dans le sol, je m’aperçois qu’il y a un effet positif sur l’érosion. Les détritus de couverts protègent le sol de la pluie, ils permettent aussi une meilleure infiltration de l’eau. Sur les pommes de terre par exemple, les détritus sont emportés par l’eau et créent naturellement des barrages entre les buttes. En revanche, sur les parcelles semées à l’automne, les semis de cultures d’hiver ne suffisent pas à couvrir les sols. Je réfléchis donc à implanter des haies, des fascines ou des bandes de couverts permanents. La seule contrainte avec les haies, c’est que du point de vue de la réglementation, on ne peut ni les bouger, ni les retirer. Je penche plutôt sur la réalisation de bandes de couverts de 20 à 30 mètres de long pour casser les flux de l’eau.
En parallèle, au niveau de mon territoire, une étude hydrologique a été menée. La seule préconisation donnée reste dans la réalisation d’un bassin en bas du bassin-versant. Je trouve cela dommage car ce n’est pas quand l’eau est récoltée en bas qu’il faut agir, c’est quand elle s’écoule de la parcelle. »
« Repasser en conventionnel»

Stéphane Pavan, président de la cuma de l’Escut (Gers).
Stéphane Pavan est président de la cuma de l’Escut dans le Gers : « La récolte était prometteuse mais on a eu de très violents orages avec beaucoup de dégâts, surtout sur la partie ouest du département. De la grêle, des inondations, du ravinement, énormément d’érosion, des champs noyés…
C’est comme si on avait passé le karcher par endroits. Moi qui suis en bio, c’est la cata. Mon fils me dit, et je le rejoins, «si on continue comme ça, dans 10 ans on est sur la roche-mère.» On envisage de repasser en conventionnel, en semis direct sous couverts végétaux. On est un paquet sur le secteur à y penser. Le sol, c’est notre capital. Il y a de fortes probabilités pour que ça se reproduise. Là, on a de la terre avec les vers de terre sur les routes. Ce sont bien sûr les cultures de printemps qui ont été les plus impactées, tournesols, maïs, soja… Pour les cultures d’hiver, comme en blé, la terre n’a pas bougé, par contre, sous ce qui s’est couché, ce n’est pas de la paille, mais du fumier. Ça a pourri et ça germe. »







